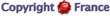Israel Galván
Locomoción Templar el templete
Dans « Locomoción, templar el templete », Israël Galvan poursuit sa recherche sur le corps sonore, dans une rencontre intimiste avec d’autres artistes, musiciens, et ici, comédienne.

Le dispositif scénique est sobre, plateau nu, à l’exception de ses « instruments », des surfaces de sol variées qui permettent au danseur de faire résonner ses pas de diverses façons ; plus les percussions d’Antonio Moreno et les instruments à vent de Juan Jimenez Alba. Tout ce qui se voit est son. Tout ce qui est nécessaire à la scène sonne ou frissonne. L’artifice ? Quelques plumes, des pantoufles, une « montera », et la fleur dans les cheveux. Et pour tout dire, la présence de la comédienne, décorative plus que nécessaire.
Pour qui connaît l’univers de l’artiste, on appréciera la continuité avec les précédents spectacles, les clins d’œil et les références. Pour qui vient découvrir ce que flamenco contemporain veut dire, il y a aussi à apprécier. La danse est comme toujours, en grande maîtrise, et tout en finesse, sans forcer ni effets racoleurs. Sa singulière danse arrive à se reconnaître entre mille, mais sans se répéter ni se caricaturer, aussi sobre que le décor, ne laissant que le son demeurer le héros de la soirée.
Ici nous avons affaire à une version comme vue et entendue à distance, d’une oreille éloignée. Des réminiscences, par vagues. Ce n’est pas la première fois qu’Israël Galvan nous partage ses visions d’un après : de l’apocalypse de « al final de este estado de cosa » aux spectres d’« el amor brujo ». Mais ici, il nous allonge l’avant. Templar en flamenco, c’est le temps qui précède le mouvement, le chant, ou le départ de la musique. C’est la préparation à quelque chose de fort. Entrer dans la danse, dans le temple (templete en espagnol) du son, du mouvement. On prend son souffle. Et le souffle est là en permanence, grâce aux nombreux instruments à vent, voix incluse. On piaffe, frotte et gronde de manière sourde grâce aux percussions, danse incluse. Un instant que le chorégraphe essaye de prolonger, de rendre protagoniste, au point de laisser le reste dans le flou d’un mirage.
La vibration sourde de l’avant et la réminiscence granuleuse de l’après encadrent une faena onirique, jusqu’au couteau, jusqu’au paso doble d’un triste triomphe, aussi lointain qu’un souvenir d’« arena » (2004), pour finir par le commencement, et faire boucler le temps jusqu’à « la métamorphose » (2000) d’après Kafka.
Dans la boîte à souvenir, les références sont celles des grands prédécesseurs du bailaor, dont, de manière centrale et récurrente, Vicente Escudero, auquel il avait déjà dédié « la curva » (2010). Ici, on le retrouve chaussé des mêmes bottines qu’Escudero sur les photos prises à Paris, par Man Ray, en 1928. Le passé hante la contemporanéité, la porte vers de nouvelles expérimentations.