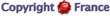El Borrico
La culture du cante flamenco sans artifices
Ce n'est pas un travail évident de résumer une vie aussi intense que celle des vieux cantaores qui, avec le temps qui passe, se sont convertis en prototypes légendaires d'une passion appelée flamenco. Les articles que l'on écrit sur le sujet essayent toujours d'offrir un résumé détaillé de leurs biographies, mais il y a toujours des mutilations textuelles involontaires en raison de l'espace. C'est-à-dire qu'il y aura toujours plus à découvrir que ce qui a été dévoilé. Eux, avec leurs voix et leurs sentiments, ont façonné la culture populaire la plus savante et riche en fondements émotionnels d'Andalousie, celle qui relate le peu de satisfactions de leurs vies et toutes les peines qu'ils eurent, avec les privations matérielles, en manque de presque tout...sauf d'arte.

Un de ces rares prodiges qui de temps en temps se déposent sur terre avec la mystérieuse force d'un éclair fut Gregorio Manuel Fernández Vargas, plus connu comme Tío Borrico ou Borrico de Jerez. Cette année on célèbre l'anniversaire du centenaire de sa naissance, et, pour des raisons évidentes, le compte-rendu biographique de cet événement ne pouvait passer inaperçu, d'autant plus maintenant, dans ces moments où presque toutes les émotions qui ne rapportent pas de bénéfices tombent dans l'oubli, nous nous acharnons à contredire la tendance au je m'en foutisme, en sauvant des noms d'importance capitale pour notre patrimoine culturel, nous pensons même qu'il y a encore des personnes qui doivent sortir, pour justice historique, à la lumière publique, pour que le lecteur en général - connaisseur en la matière ou simple profane - sache valoriser comme il se doit ceux qui offrirent leurs sens pour donner forme au cante jondo.
Il fut un temps, le temps où les hommes n'étaient pas contaminés par les crédits, le pétrole, la téléphonie mobile ou la mode, dans lequel la communauté avait une conscience collective, savait qu'elle appartenait à une terre et que ses actions, pauvres mais solidaires, déterminaient la formation de la culture d'un peuple à long terme. Cette germination profonde des graines, qui en Andalousie en général et à Jerez de la Frontera en particulier donnèrent lieu au flamenco, fait pousser maintenant avec force à la superficie de nouvelles références, à l'époque actuelle de l'enjôlement capitaliste, où les gens ont perdu la notion de ce qui fut, parce qu'ils ne souhaitent pas s'en souvenir, avec le puéril argument de ne pas souffrir de façon inutile. L'hédonisme trivial s'impose et le prix à payer pour cela est le cruel oubli des racines.
Gregorio Manuel Fernández Vargas est né en 1910 à Jerez de la Frontera, village de la province de Cádiz, dont le travail naturel était lié au monde du vin. L'industrie viticole est en déclin depuis plusieurs décennies mais Jerez continue d'exporter ses fameux crus dans le monde entier. L'année de la naissance d'El Borrico fut ce que l'on a appelé celle de "L'espérance des ouvriers du champ", ces ouvriers pauvres qui se tuaient à la tâche - encore plus en Andalousie - de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec la création de l'anarchiste Confédération Nationale du Travail, syndicat révolutionnaire et de grande valeur culturelle qui essaya de combattre l'injustice des propriétaires terriens et la misérable existence des ouvriers et paysans, répartissant les terres et les usines entre les véritables protagonistes du processus productif : les travailleurs. Cette année-là, comme je l'ai dit, vint au monde un descendant direct du mythique cantaor Paco La Luz, génie du 19ème siècle qui inaugura une branche généalogique de grande prédilection dans le flamenco. De plus, Tío Borrico était le fils d'El Tati et le neveu de Juanichi El Manijero, des hommes tous liés à la culture agraire comme les souches des vignes jerezanas le sont à la terre arride. Sa fille, María La Burra, est la fidèle héritière du legs de son père. Et dans ce ferment social, celui du champ, surgirent les pénibles peines, le dégoût d'une époque qui ne change pas, et la necessité de l'arte jondo, celui qui depuis le plus enfoui et mystérieux de l'être humain s'élève jusqu'à des limites impossibles. Un défi dans lequel, comme disait Protágoras, "l'homme est le mesure de toutes les choses".
La tessiture de voix d'El Borrico, dans la classificarion qu'établit la flamencologie est afillá, c'est à dire similaire à celle qu'avait le célèbre cantaor du 19ème siècle El Fillo, ce type de voix rauque, grave, pas du tout douce, au contraire. Sa particularité tonale lui conférait un caractère très authentique, celui de quelqu'un qui n'est pas passé par des académies de chant pour laver ses impuretés interprétatives. Si cela avait été le contraire, El Borrico ne serait pas reconnu et admiré. Les cantaores d'antan n'avaient pas besoin d'académies... Parce que c'était eux les académies ! Ils géraient, à la sueur de leur travail et la faim de leurs estomacs la culture du sang, comme aurait dit Federico García Lorca. Mais il y a quelque chose en plus : les cultures sont, en plus d'être des modes de vie et des coutumes ancestrales, des projets d'émancipation. Le cante servait à ce que ces hommes des gañanias puissent échapper un moment à la misère, juste le temps nécessaire pour oublier leurs préoccupations intérieures.
La professionnalisation fut tardive pour Gregorio Manuel qui était déjà un homme d'un âge avancé quand il abandonna les outils du champ pour la chaise en pin des scènes. Dans les dernières années de sa vie (il mourut en 1983), la maladie et la pauvreté l'accaparèrent complètement et il n'avait presque plus de récitals. Il en avait passé du temps depuis que ces arrogants señoritos de la haute bourgeoisie jerezana, presque propriétaires physiques des travailleurs à travers un système proche de la féodalité, avaient baptisé comme Borrico le protagoniste de notre récit. Il s'agissait d'Alfonso Domecq et González, qui en écoutant comment chantait le neveu d'El Manijero à 19 ans dit "Quelle voix bestiale, quelle énormité ! C'est la voix la plus brute et la plus bête !". C'est pourquoi la figure du señorito faisait peur dans la ville de Jerez. Ses décisions, pour arbitraires et despotiques qu'elle fussent, étaient respectées avec une peur presque révérencieuse, car la bourgeoisie et la noblesse terrienne ont toujours fait, littéralement, ce qu'ils voulaient de leurs employés, les traitant avec indifférence, quand ce n'était pas de l'humiliation pure et dure : des conditions de travail infrahumaines, l'obligation d'assister aux offices catholique, le droit de cuissage etc... C'est pour cela qu'il est surprenant que Jerez, aujourd'hui, ne tue pas dans l'oeuf ce pernicieux héritage esclavagiste et n'établisse, comme il se doit, une légitime culture du peuple.
El Borrico a passé une grande partie de son existence dans la province de Cádiz, où il a développé quasiment tout son travail artistique avec de grands noms comme ceux de Paco Espinosa, El Batato, Luisa La Torrán ou même Lola Flores en personne. Il chantait dans des ventas et colmaos de Jerez, au début en combinant cet engagement naissant dans le cante avec ce qui continuait à être sa plus grande source de revenus : le champ. Un fait important de la carrière d'El Borrico fut son récital à la Venta Casablanca avec un couple (sentimental et artistique) qui donna de brillants moments de gloire au flamenco : Pastora Pavón "La Niña de los Peines" et Pepe Pinto. Une autre étape d'intérêt capital fut en 1967 lorsque la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera, à l'initiative de son directeur Juan de la Plata, le convainquit de participer à un récital accompagné à la guitare par son neveu Parrilla. Là-bas, sa Soleá por Bulería marquera tant qu'il participe peu de temps après à la Fiesta de la Bulería - événement annuel qui se célèbre chaque mois de septembre à la Plaza de Toros - où on lui remet la Copa Jerez. Depuis lors rien ne sera plus jamais pareil. Tout change, jusqu'à ce qu'on vende des enregistrements discographiques qui immortalisent la voix et l'écho d'El Borrico. Célèbre et génial parmi tous, digne d'éloge et des plus grands louanges, c'est le disque "Canta Jerez" qui réunit de prodigieux artistes de la terre jerezana, dont entre autres le propre Gregorio, qui laissèrent une empreinte indélébile dans les microsillons des vieux disques vynil. Son rayonnement, maintenant, atteint désormais d'autres provinces andalouses comme Grenade, où il est le sujet d'une conférence de Manuel Ríos Ruiz.
La mort, l'épilogue de son existence, survient à un âge relativement jeune, alors qu'il était, pourrions-nous dire au sommet de sa carrière flamenca. A73 ans décède d'une thrombose cérébrale l'un des cantaores avec le plus de duende de l'histoire, reconnu pour son style, la classe et la saveur avec lesquelles il interprétait les grands palos du patrimoine jondo comme la soleá, la siguiriya ou le martinete. José Luis Ortiz Nuevo écrit un livre où il rassemble les mémoires du cantaor. De plus, après la disparition d'El Borrico, on dédie une rue à son nom, et bien sûr, on lui rend un hommage auquel participent entre beaucoup d'autres, des artistes de prestige comme Tía Anica La Piriñaca et Tía Juana la del Pipa.
En résumé Gregorio Manuel Fernández Vargas fut un personnage vrai, digne représentant d'une époque bohémienne dans laquelle les cantaores, avant tout, renonçaient à considérer le flamenco comme une simple affaire sujette à des formules commerciales s'ils ne trouvaient pas de motifs ou fondements intérieurs suffisants pour s'en détacher. Rappelons la phrase inoubliable de Don Antonio Chacón “¿Saben los señores escuchar?” (messieurs savez-vous écouter ?). Aucun ne renonçait a ses rémunérations, logiquement, mais pour tous il était clair du départ que le cante ne pouvait sortir d'un carnet de chèques si avant on ne l'avait pas sorti de ses propres entrailles. Et maintenant, que reste-t-il ? c'est l'éternelle question rhétorique de laquelle les générations actuelles désirent se protéger, dans l'espoir qu'arrive un jour où l'afición au cante ne décline plus et où les caractéristiques du flamenco de toujours conservent la pureté avec toute l'intensité, au dessus des modes éphémères et passagères, des gros nuages commerciaux éthérés qui déchargent une averse millionnaire sur les autres. Des attitudes qui laissent inertes la culture et l'idiosyncrasie de l'art flamenco. Par chance, il nous restera toujours El Borrico et tant d'autres pour se souvenir des gens aux pieds enracinés et à la tête à l'air libre, chantant sans additifs, avec le compás ferme du battement de leurs coeurs.